Acte anormal de gestion : méthode de preuve et pertinence des comparables
- Rodolphe Rous
- 10 oct. 2025
- 8 min de lecture

La notion d’acte anormal de gestion est l’un de ces concepts à la fois commodes et périlleux du droit fiscal français : commode pour l’administration qui y voit un levier de réintégration des charges ou de requalification de certains flux, périlleux pour les entreprises lorsqu’elle est maniée sans exigence suffisante de preuve et de méthode. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles le 25 septembre 2025 (n° 23VE00051) offre une mise au point salutaire. Il rappelle avec force que, lorsque l’administration prétend qu’une société a cédé des actifs à prix minoré constitutif d’un avantage occulte (art. 111, c du CGI), la charge de la preuve, la pertinence des comparables et la cohérence de la méthodologie d’évaluation conditionnent la validité du rehaussement.Le commentaire de Franck Laffaille (Lexbase, 6 octobre 2025) éclaire utilement ce cadre et la logique décisionnelle de la Cour. Nous suivrons ici cette trame pour en dégager les leçons pratiques.
I. Les faits, la procédure et la décision : ce que la CAA a réellement jugé
L’espèce se déroule en 2013–2014 autour de la cession, par une SARL alors en redressement judiciaire, d’une maison d’habitation et de locaux professionnels à des SCI détenues à 99 % par M. B C. Les prix consentis sont de 90 000 € (maison) et 70 000 € (locaux). L’année suivante, l’intégralité des parts de ces SCI est cédée à M. A pour 1 €. S’estimant en présence d’un prix délibérément minoré, l’administration réévalue les biens à 164 000 € (maison) et 102 960 € (locaux) à partir d’approches dites « comparatives » corrigées par divers abattements (vétusté, désamiantage, servitudes, accessibilité), et notifie des suppléments d’IR, contributions sur les hauts revenus et prélèvements sociaux à M. B C, sur le fondement de l’article 111, c du CGI (rémunérations et avantages occultes), la base procédant de l’écart entre prix convenu et valeur vénale estimée.
Le tribunal administratif de Versailles (27 sept. 2022, n° 2006378) prononce la décharge des impositions supplémentaires. Le ministre relève appel, soutenant que la minoration est « significative », que l’attestation notariale produite par le contribuable serait insuffisante, et que le PLU invoqué pour les locaux n’était pas applicable lors de la cession. Il insiste : les prix retenus ne lui paraissent pas « exagérés » au regard des comparaisons opérées.
La CAA de Versailles, par son arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23VE00051), confirme le jugement et rejette l’appel du ministre. Deux lignes de force structurent sa motivation :
Charge et degré de preuve. En matière d’avantage occulte au sens de l’art. 111, c du CGI, il incombe à l’administration d’établir, d’une part, un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale et, d’autre part, l’existence d’un accord de volontés tendant à octroyer et recevoir une libéralité. La Cour rappelle ce standard probatoire avec netteté.
Pertinence et cohérence de la comparaison. La méthode suivie par l’administration se révèle défaillante : défaut de comparables réellement équivalents, éviction tardive de la plupart des références au motif de surfaces non pertinentes, sous-estimation des nuisances, de l’isolement, du coût du désamiantage et de la vétusté. Surtout, la Cour constate que la maison est difficilement cessible isolément : elle n’a quasiment de sens que dans le cadre d’une cession globale de l’ensemble immobilier comprenant les bâtiments professionnels contigus.
À ces critiques s’ajoute un élément conjoncturel décisif : les ventes interviennent sous l’empire d’une procédure collective, avec accord de la banque hypothécaire, et ont été entérinées par le tribunal de commerce, l’opération permettant la poursuite de l’activité dans les locaux et le logement du dirigeant dans la maison attenante. Autrement dit, le prix n’est pas un caprice ; il est la contrepartie d’une solution de redressement économiquement rationnelle.
Le rehaussement tombe donc, faute de démonstration d’un avantage occulte ; aucune libéralité n’est suffisamment caractérisée. La Cour agit ici en juge du concret économique, révélant l’inadéquation d’un comparatisme bâclé et la nécessité d’embrasser l’économie globale de l’opération.
II. “Acte anormal de gestion” et avantage occulte (art. 111, c CGI) : cadre juridique et exigences probatoires
La doctrine et la jurisprudence articulent deux voies classiques de remise en cause par l’administration :– la qualification d’acte anormal de gestion, qui vise les décisions par lesquelles l’entreprise renonce à un profit ou supporte une charge sans intérêt pour l’exploitation ;– la requalification en avantage occulte (art. 111, c du CGI), lorsque la minoration d’un prix ou la gratuité d’un avantage s’analyse en libéralité constitutive de revenus distribués.
En pratique, ces deux constructions se télescopent souvent : la vente à prix minoré est l’archétype de l’acte anormal de gestion et du bénéfice distribué. Mais la Cour rappelle que ce télescopage n’autorise ni présomptions irréfragables, ni approximations. Trois enseignements méritent d’être soulignés.
1. L’anormalité n’est pas un jugement de valeur, c’est une démonstration.
On ne se contente pas d’affirmer qu’un prix est « bas ». Il faut prouver qu’il est sans contrepartie ou disproportionné au regard d’éléments objectifs, en considérant toutes les circonstances : état et localisation du bien, servitudes, nuisances, travaux imposés (désamiantage), situation de marché et, ici, cadre judiciaire de la vente.
2. L’avantage occulte suppose un double faisceau.
D’abord, un écart significatif objectivement mesuré entre prix et valeur vénale ; ensuite, un accord intentionnel d’octroyer/recevoir une libéralité. La seconde branche est trop souvent escamotée. En contexte de procédure collective, la rationalité économique de l’opération et son contrôle juridictionnel affaiblissent puissamment la thèse d’une libéralité.
3. La méthode des comparables a des règles.
Un comparable n’est pas « proche » parce qu’il se situe dans le même département ou qu’il partage une catégorie cadastrale. Il faut une équivalence fonctionnelle (type de locaux : industriels ou agricoles ?), urbanistique (zonage, densité), technique (état, désamiantage, desserte), économique (attractivité, bassin d’emploi).
À défaut, la “jurisprudence de l’écart” se transforme en jurisprudence de l’à-peu-près.
Cette exigence probatoire irrigue également le contrôle de l’acte anormal : l’entreprise peut renoncer à un profit apparent si elle s’inscrit dans une stratégie rationnelle (préserver l’outil de production, négocier sous contrainte collective, éviter des coûts supérieurs à court terme).
Le juge, s’il comprend l’économie de l’opération, admet que l’optimum économique n’est pas nécessairement l’optimum fiscal.
III. Le démontage méthodologique par la Cour : pourquoi les comparaisons de l’administration ne tiennent pas
L’arrêt décrit une méthode administrative instable. D’abord, l’administration affiche plusieurs comparables (quatre maisons, trois locaux) ; puis, in fine, n’en retient presque plus qu’un seul – au motif que les autres seraient « non pertinents » en surface. Cette évaporation des références trahit le caractère postulé de la valorisation : on se crispe sur la valeur cible, puis l’on élimine les chiffres qui s’y opposent. Le juge n’y voit pas un choix raisonné, mais une confirmation biaisée.
Ensuite, les abattements concédés (10 % vétusté, 20 % désamiantage) sont déconnectés des coûts réels. Or, la pertinence d’un abattement ne s’évalue pas dans l’absolu ; elle se mesure à l’aune du reste à charge pour un acquéreur rationnel. Si l’amiante impose des travaux dont la moitié seulement est couverte par l’abattement, la valeur économique du bien demeure affectée au-delà des 20 % retenus. La CAA s’en tient à cet impact économique – ce que l’administration néglige.
Troisièmement, les nuisances (mitoyenneté avec une entreprise de BTP), l’isolement rural (commune de 500 habitants) et la contiguïté des biens ne sont pas des détails pittoresques : elles déterminent la liquidité et la cessibilité. L’administration compare à un bien situé en zone pavillonnaire d’une commune de 3 500 habitants, sans nuisance notable. « On compare ce qui n’est pas comparable » : l’arrêt l’illustre par ses constats factuels.
Enfin, le contexte de la procédure collective emporte des conséquences juridiques : les ventes sont supervisées (accord de la banque hypothécaire, jugement du tribunal de commerce), poursuivent un but (maintien de l’activité, logement du dirigeant), et répondent à une contrainte de marché. La valeur n’est pas une valeur idéale ; c’est une valeur transactionnelle dans un environnement contraint. Lorsque l’administration ignore cet environnement, elle dévalorise la rationalité de la décision d’entreprise et surestime sa propre capacité d’évaluation.
De cette démonstration, la Cour tire une conclusion ferme : l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une libéralité constitutive d’avantage occulte. L’écart de prix, tel qu’établi, n’est pas suffisamment significatif au regard des données du dossier, et surtout, il ne révèle pas l’intention d’avantager.
IV. Enseignements pratiques et recommandations pour les entreprises et leurs conseils
Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt de la CAA de Versailles (25 sept. 2025, n° 23VE00051) délivre quatre messages utiles aux acteurs économiques et à leurs conseils.
1. Documenter la rationalité économique dès l’origine.
Dans tout projet de cession d’actifs atypique (prix bas, contexte dégradé, contraintes techniques), la traçabilité de la raison d’entreprise est essentielle : notes internes, chronologie des démarches, devis des travaux (désamiantage, remise aux normes), éléments de marché local, échanges avec les créanciers. Cette documentation deviendra, le cas échéant, la preuve que le prix retenu n’est ni libéralité ni renoncement gratuit, mais compromis rationnel face aux contraintes.
2. Exiger de l’administration une comparaison honnête.
Un comparable doit être équivalent. On n’oppose pas à un hangar agricole non bétonné un atelier industriel raccordé, pas plus qu’on n’assimile une commune rurale à une zone pavillonnaire attractive. La défense doit cartographier les écarts : zonage, desserte, nuisances, population, surface utile, hauteur libre, charges futures. À défaut, la valeur « moyenne » n’est qu’un artefact.
3. Valoriser l’effet “procédure collective”.
Les ventes sous contrôle judiciaire répondent à une logique de sauvegarde. L’accord bancaire, la validation juridictionnelle et l’intérêt social (continuité d’exploitation, maintien d’emplois, maîtrise des dettes) pèsent contre la thèse de l’avantage occulte. Il faut faire parler ces contraintes : elles expliquent le prix et absorbent la critique de libéralité.
4. Ne pas surévaluer les attestations notariales… mais ne pas les sous-estimer.
Une attestation notariale n’a pas à détailler tous ses comparables pour être prise en compte. Certes, elle n’est pas parole d’évangile ; mais, adossée à des constats techniques et à un contexte judiciaire clair, elle devient un indice sérieux. Dans l’arrêt, la proximité des prix de vente et de l’estimation notariale a joué en faveur du contribuable.
5. Anticiper la “jurisprudence de l’écart”.
L’administration raisonne souvent en pourcentages : –32 %, –45 %. Ces chiffres impressionnent, mais ne disent rien en eux-mêmes. Un écart doit être expliqué et corrélé à des réalités techniques et économiques. L’argumentaire de défense doit démontrer pourquoi un pourcentage « important » peut être normal dans une situation donnée (travaux, nuisances, absence de marché, contiguïté limitative).
6. Relier l’“acte anormal” à l’intérêt de l’entreprise, pas à l’“idéal” administratif.
Le droit fiscal n’impose pas la maximisation du prix en toute circonstance. Il impose d’éviter la libéralité. Si l’entreprise, au vu des alternatives, choisit la solution la moins destructrice de valeur (même à prix bas) pour éteindre un passif, sauver l’activité ou limiter des coûts structurels, l’acte n’est pas anormal. La Cour en donne une illustration convaincante.
Conclusion : un rappel d’hygiène méthodologique… et un message de sécurité juridique
L’arrêt CAA Versailles, 25 sept. 2025, n° 23VE00051, est d’abord un rappel d’hygiène : la notion d’acte anormal de gestion ne saurait devenir le réceptacle de toutes les intuitions fiscales. La preuve de la libéralité au sens de l’art. 111, c du CGI ne se présume pas ; elle se démontre par une méthode rigoureuse, des comparables réellement équivalents, et une prise en compte loyale du contexte économique et judiciaire.
C’est ensuite un message de sécurité juridique pour les entreprises : lorsqu’elles agissent dans un environnement contraint, qu’elles documentent leur choix et que le prix résulte d’une logique compréhensible (et parfois validée par le juge commercial), la critique d’avantage occulte ne peut prospérer sur des approximateurs.Enfin, c’est une invitation faite aux praticiens à articuler la défense autour de l’économie de l’opération plus que sur la seule bataille de chiffres. La fiscalité ne peut ignorer la réalité des affaires : c’est précisément ce que rappelle la Cour de Versailles.
Références :
– CAA Versailles, 25 septembre 2025, n° 23VE00051.– TA Versailles, 27 septembre 2022, n° 2006378.
– CGI, art. 111, c (revenus distribués : avantages occultes).
– Franck Laffaille, « Les errements de l’administration fiscale en matière d’acte anormal de gestion », Lexbase, 6 octobre 2025.
Mots-clés : Acte anormal de gestion – Avantage occulte – Article 111, c CGI – Prix minoré – Comparables – Désamiantage – Vétusté – Procédure collective – Jurisprudence de l’écart – Sécurité juridique.


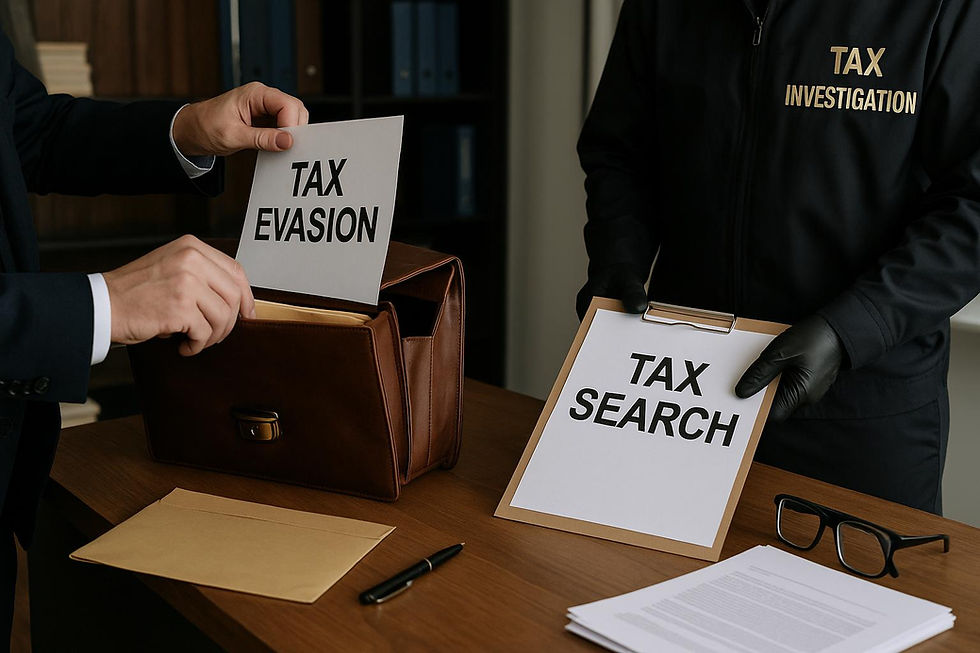

Commentaires