Quelques mots sur la perquisition fiscale
- Rodolphe Rous
- 7 août 2025
- 15 min de lecture
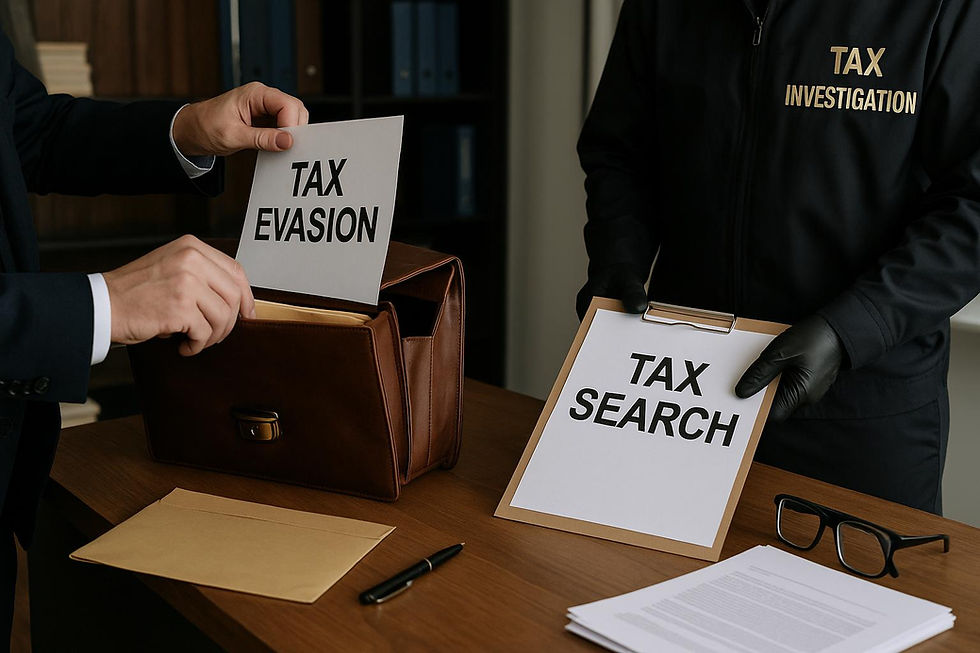
La lutte contre la fraude fiscale est devenue, au fil des décennies, une priorité absolue pour l’État. Le développement de mécanismes sophistiqués d’évasion et de dissimulation a conduit le législateur français à doter l’administration fiscale d’un arsenal de plus en plus intrusif. Au sommet de cet arsenal se trouve une procédure redoutée : la perquisition fiscale, ou « visite domiciliaire », prévue à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF).
Cet instrument, comparable à une perquisition pénale, permet à l’administration, sous le
contrôle étroit du juge, de pénétrer dans les locaux d’une entreprise ou au domicile d’un contribuable afin d’y rechercher des preuves matérielles de fraude. C’est une mesure exceptionnelle, par son intensité comme par ses conséquences, puisqu’elle touche au cœur même de la vie privée et professionnelle des personnes concernées.
Longtemps perçue comme marginale, la perquisition fiscale s’est imposée comme un élément central de la lutte contre la fraude organisée, notamment en raison de la montée en puissance des enquêtes fiscales d’envergure. Elle illustre à la fois l’efficacité recherchée par l’administration et la vigilance qu’impose l’État de droit pour préserver les libertés individuelles.
L’objet de cet article est de dresser une étude approfondie et complète de cette procédure, en en présentant les bases juridiques, les conditions de mise en œuvre, le déroulement concret, les droits et garanties offerts aux contribuables, l’exploitation des éléments saisis, ainsi que les perspectives jurisprudentielles et doctrinales. L’ambition est de livrer un panorama clair et utile, tant aux praticiens du droit qu’aux dirigeants d’entreprises ou aux particuliers soucieux de comprendre les mécanismes qui peuvent un jour les concerner.
I. Le cadre juridique de la perquisition fiscale
A. Les fondements légaux
La perquisition fiscale trouve son ancrage dans un texte spécifique du Livre des procédures fiscales : l’article L. 16 B. Introduit par la loi du 29 décembre 1984, il répondait au besoin de renforcer la lutte contre la fraude fiscale organisée, en donnant à l’administration des moyens comparables à ceux de la procédure pénale.
L’article L. 16 B dispose que, lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt en se livrant à des manœuvres frauduleuses, les agents de l’administration des finances publiques, dûment habilités, peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, procéder à la visite de tous locaux, y compris à usage d’habitation, pour rechercher la preuve de cette fraude et saisir les documents utiles.
Ce texte confère donc à l’administration fiscale un pouvoir intrusif, mais il ne s’exerce qu’à travers l’intermédiation d’un juge. La mesure est justifiée par la gravité des comportements visés : fraude organisée, dissimulation de recettes, comptabilité occulte, usage de prête-noms ou encore transferts frauduleux à l’étranger.
Au-delà du LPF, la perquisition fiscale s’articule avec d’autres branches du droit :
Le Code pénal, qui sanctionne la fraude fiscale (article 1741) et son blanchiment.
Le Code de procédure pénale, auquel elle emprunte certains mécanismes, même si elle conserve un régime autonome.
La singularité de la visite domiciliaire fiscale réside dans cette hybridité : elle n’est pas une mesure pénale à proprement parler, mais une mesure administrative judiciarisée, tournée vers la recherche de la preuve.
B. L’autorité compétente
La visite domiciliaire ne peut être effectuée qu’avec l’aval d’un juge. La compétence revient au juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire du ressort dans lequel se situe le lieu de visite.
L’ordonnance du JLD doit être préalablement sollicitée par l’administration fiscale. La requête est écrite, motivée et doit exposer les éléments laissant présumer l’existence d’une fraude.
Le juge apprécie alors la pertinence et la proportionnalité de la mesure.
La jurisprudence est exigeante : la décision doit être suffisamment motivée, à peine de nullité. La Cour de cassation a maintes fois rappelé que l’ordonnance doit indiquer les éléments concrets et précis justifiant la visite, et non se borner à des considérations générales sur la lutte contre la fraude.
Le contrôle juridictionnel en amont est donc l’une des garanties majeures de la procédure.
C. Les conditions de déclenchement
La perquisition fiscale suppose l’existence de présomptions de fraude. Il ne suffit pas de simples soupçons : l’administration doit présenter au juge des indices sérieux, tels que l’existence de factures fictives, de comptes bancaires occultes, ou encore de structures écrans.
La mesure est en outre subsidiaire : elle ne doit être utilisée que lorsque d’autres moyens de contrôle ne permettent pas d’obtenir les preuves recherchées. Cette exigence découle du principe de proportionnalité, qui irrigue tant le droit interne que la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, la visite peut concerner aussi bien des locaux professionnels que le domicile privé du contribuable, dès lors que l’ordonnance le prévoit. L’atteinte aux libertés est alors maximale, ce qui explique la vigilance particulière de la jurisprudence.
II. Le déroulement de la perquisition fiscale
Si l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est délivrée, la procédure peut être mise en œuvre. Elle est encadrée avec précision par le Livre des procédures fiscales et par une jurisprudence abondante, qui tend à concilier l’efficacité de l’action de l’administration et le respect des libertés individuelles.
A. Les acteurs de la visite
1. Les agents de l’administration fiscale
Seuls certains agents des finances publiques, spécialement habilités, peuvent procéder à la perquisition. L’habilitation est individuelle et nominative, et elle conditionne la régularité de la mesure. Ces agents doivent, lors de la visite, présenter leur commission et l’ordonnance du juge.
2. Le concours de la police judiciaire
L’article L. 16 B du LPF prévoit la possibilité pour les agents de l’administration d’être assistés par les officiers et agents de police judiciaire. Ce concours est précieux, notamment pour assurer le maintien de l’ordre, ouvrir des locaux ou procéder à des saisies sensibles. Il souligne la gravité de la procédure, qui rapproche la perquisition fiscale de la perquisition pénale.
3. La présence de l’occupant ou d’un représentant
La visite doit, autant que possible, se dérouler en présence de l’occupant des lieux. En son absence, elle peut avoir lieu en présence de son représentant, ou à défaut de deux témoins indépendants choisis par l’huissier de justice. Cette présence garantit la transparence des opérations et permet de dresser un procès-verbal incontestable.
4. Le rôle de l’huissier de justice
La procédure impose l’assistance d’un huissier de justice. Celui-ci dresse procès-verbal des opérations, constate le déroulement des recherches et authentifie les saisies. Sa mission est essentielle : il confère une valeur probatoire particulière aux actes de la visite et protège contre toute contestation ultérieure sur la régularité des opérations.
B. Le périmètre de la visite
La perquisition fiscale peut concerner différents lieux, définis par l’ordonnance du juge.
1. Les locaux professionnels
Ce sont les lieux les plus fréquemment visés : bureaux, ateliers, commerces, entrepôts, cabinets. L’administration y recherche les éléments matériels d’une comptabilité occulte, de factures falsifiées ou de transactions dissimulées.
2. Le domicile privé
La mesure peut aussi viser le domicile du contribuable ou d’un tiers, si le juge estime que des documents s’y trouvent. C’est une intrusion particulièrement sensible, car elle touche à la sphère intime protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence européenne a exigé que ces intrusions soient proportionnées et entourées de garanties renforcées.
3. Les lieux mixtes
Nombreuses professions exercent à domicile : professions libérales, travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs. Dans ce cas, la visite peut s’étendre à la fois aux pièces affectées à l’activité professionnelle et aux pièces personnelles, à condition que l’ordonnance le prévoie. La distinction pratique est souvent délicate, ce qui accroît le risque de contestation.
C. Les opérations matérielles
1. Modalités d’accès et d’ouverture des locaux
L’administration peut demander l’ouverture de tous meubles ou locaux susceptibles de contenir des documents utiles. En cas de refus, elle peut requérir le concours de la force publique. L’huissier consigne dans son procès-verbal les conditions d’accès et d’ouverture.
2. Saisies de documents physiques
Les agents peuvent saisir tout document utile : livres comptables, factures, contrats, relevés bancaires. Les documents sont placés sous scellés, et leur inventaire est annexé au procès-verbal.
3. Saisies informatiques
L’évolution des pratiques a rendu la saisie électronique incontournable. Les agents peuvent accéder aux ordinateurs, serveurs, téléphones, tablettes, et en extraire les données pertinentes. Ils peuvent aussi copier le contenu de disques durs ou de clés USB. Cette dimension numérique soulève des difficultés techniques et juridiques, notamment quant au respect du secret professionnel et à la proportionnalité des saisies.
4. Limites liées aux correspondances protégées
Certaines correspondances bénéficient d’une protection particulière : les échanges entre un avocat et son client sont couverts par le secret professionnel, sauf s’il existe des indices de participation de l’avocat à une fraude. L’administration ne peut pas librement saisir ces documents. De même, des règles spécifiques protègent les données médicales ou les correspondances personnelles manifestement étrangères à la fraude.
III. Les droits et garanties du contribuable
La perquisition fiscale, par son intensité, appelle des contreparties solides en termes de droits de la défense. Sans garanties, l’équilibre entre efficacité et libertés individuelles serait rompu. Le législateur et la jurisprudence ont donc progressivement construit un ensemble de protections dont le contribuable peut se prévaloir.
A. L’information et la transparence
1. Notification de l’ordonnance
Dès le début des opérations, l’administration doit notifier à l’occupant des lieux l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette communication permet au contribuable de prendre connaissance de la portée exacte de la visite, des motifs retenus par le juge et de l’étendue des pouvoirs des agents.
2. Présentation des droits de la défense
L’ordonnance rappelle également les droits du contribuable, notamment la possibilité de contester la régularité de la procédure. La présence de l’huissier et le caractère contradictoire de la visite assurent une certaine transparence dans le déroulement des opérations.
3. Possibilité d’assistance par un conseil
Le contribuable peut faire appel à un avocat pour assister à la perquisition. La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une faculté essentielle pour garantir les droits de la défense. En pratique, la rapidité des opérations et leur effet de surprise rendent parfois difficile la présence immédiate d’un conseil, mais celle-ci reste fortement recommandée.
B. Les recours contre l’ordonnance
1. L’appel devant le Premier président de la cour d’appel
L’ordonnance du JLD n’est pas insusceptible de recours. Le contribuable dispose de la faculté de former appel devant le Premier président de la cour d’appel. Cet appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Délais et modalités pratiques
L’appel n’est pas suspensif : la visite peut donc avoir lieu avant que la cour n’ait statué. Toutefois, si l’appel est accueilli et l’ordonnance annulée, toutes les opérations réalisées en vertu de celle-ci sont frappées de nullité.
3. Jurisprudence sur l’annulation des ordonnances irrégulières
La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, sanctionné des ordonnances insuffisamment motivées ou reposant sur des présomptions trop générales. Elle exige que les indices de fraude soient concrets et individualisés (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-17.456). La sanction de l’irrégularité est radicale : l’annulation entraîne la restitution de tous les documents saisis et l’impossibilité de les exploiter.
C. La protection des droits fondamentaux
1. Article 8 de la CEDH : respect du domicile et de la vie privée
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler que les visites domiciliaires constituent une ingérence dans le droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention. Elles ne sont admissibles que si elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime (la lutte contre la fraude fiscale) et sont proportionnées.
2. Jurisprudence de la CEDH
Dans l’arrêt Ravon c. France (21 février 2008), la Cour a jugé que la France ne prévoyait pas de voies de recours effectives contre les ordonnances autorisant les perquisitions fiscales. Cette décision a conduit à une réforme profonde de l’article L. 16 B du LPF et à la création du recours devant le Premier président de la cour d’appel. Plus récemment, la CEDH a insisté sur la nécessité d’un contrôle juridictionnel effectif et d’une motivation précise des décisions (arrêt Vinci Construction c. France, 2 avril 2015).
3. Principe de proportionnalité et contrôle de la Cour de cassation
La Cour de cassation, alignée sur la jurisprudence européenne, veille à ce que les mesures ordonnées ne soient pas excessives par rapport aux objectifs poursuivis. Elle contrôle la proportionnalité entre l’atteinte portée à la vie privée et l’intérêt de la lutte contre la fraude. Ce contrôle renforce la sécurité juridique des contribuables et incite les juges à motiver de manière rigoureuse leurs ordonnances.
IV. L’exploitation des éléments saisis
La perquisition fiscale n’est pas une fin en soi. Elle vise à collecter des éléments matériels permettant d’établir la réalité d’une fraude et de les exploiter, tant sur le plan fiscal que sur le plan pénal. L’utilisation de ces documents est strictement encadrée : leur exploitation doit respecter les droits de la défense et les principes de loyauté de la preuve.
A. Sur le plan fiscal
1. Utilisation des documents dans une procédure de rectification
Les documents saisis lors d’une visite domiciliaire peuvent être exploités par l’administration pour fonder une procédure de rectification. Par exemple, la découverte d’une comptabilité occulte ou de factures fictives peut conduire à la reconstitution du chiffre d’affaires et à la notification de rappels d’impôts assortis de pénalités lourdes.
2. Articulation avec la procédure de contrôle contradictoire
Même si les preuves ont été obtenues dans le cadre d’une perquisition, l’administration doit ensuite respecter les garanties procédurales prévues dans la procédure de rectification contradictoire (articles L. 55 et suivants du LPF). Le contribuable conserve donc la possibilité de présenter ses observations, de demander des justifications ou de saisir la commission départementale compétente.
3. Contestation de la régularité de l’exploitation
Le contribuable peut soulever devant le juge de l’impôt la nullité des opérations de visite, si elles ont été réalisées en méconnaissance des règles applicables. En cas d’irrégularité, les pièces obtenues ne peuvent pas être utilisées. Ce mécanisme protège le contribuable contre des atteintes abusives.
B. Sur le plan pénal
1. Transmission au parquet
Si les agents découvrent des éléments laissant présumer l’existence d’une fraude fiscale, ils peuvent transmettre le dossier au parquet. Cette transmission s’inscrit dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, prévue à l’article 1741 du Code général des impôts.
2. Utilisation pour des infractions connexes
Au-delà de la fraude fiscale stricto sensu, les pièces saisies peuvent alimenter des enquêtes pour blanchiment de fraude fiscale (article 324-1 du Code pénal), corruption, abus de biens sociaux ou infractions douanières. La perquisition fiscale devient ainsi un point d’entrée pour des investigations plus larges.
3. Cumul des sanctions fiscales et pénales
La question du cumul des poursuites fiscales et pénales a longtemps été discutée au regard du principe non bis in idem. La jurisprudence française et européenne admet désormais ce cumul, à condition qu’il existe un lien de complémentarité entre les procédures et que l’ensemble des sanctions ne dépasse pas le seuil de proportionnalité. Les documents saisis lors d’une perquisition peuvent donc nourrir à la fois une procédure fiscale et une procédure pénale.
C. Risques spécifiques pour l’entreprise
1. Réputation et impact médiatique
L’existence d’une perquisition fiscale, surtout lorsqu’elle est médiatisée, peut gravement entacher l’image d’une entreprise. Même en l’absence de condamnation, la simple révélation de la procédure peut susciter une suspicion durable auprès des clients, partenaires ou investisseurs.
2. Conséquences contractuelles et bancaires
Une perquisition peut amener les partenaires contractuels à s’interroger sur la fiabilité de l’entreprise. Les établissements bancaires, dans un contexte de vigilance accrue en matière de blanchiment, peuvent décider de restreindre leurs relations avec une société visée par de telles opérations.
3. Répercussions en matière de gouvernance et de responsabilité des dirigeants
La découverte d’irrégularités peut engager la responsabilité personnelle des dirigeants, tant sur le plan fiscal que sur le plan pénal. Elle peut également déclencher des actions en responsabilité civile, notamment de la part des actionnaires ou créanciers.
V. Stratégies de défense et conseils pratiques
Face à la perspective ou à la réalité d’une perquisition fiscale, le contribuable et ses conseils doivent adopter une attitude réfléchie. L’enjeu est considérable : la manière dont les opérations sont conduites et gérées peut conditionner la suite du contentieux, tant fiscal que pénal. Trois moments doivent être distingués : avant, pendant et après la perquisition.
A. Avant la perquisition : anticipation et prévention
1. La mise en place d’une politique de conformité fiscale
La première ligne de défense consiste à réduire le risque de déclenchement d’une telle procédure. Les entreprises ont intérêt à mettre en place une véritable politique de « compliance fiscale », qui inclut :
un suivi rigoureux des obligations déclaratives ;
une documentation complète des flux financiers et commerciaux ;
une vigilance particulière en matière de prix de transfert, de facturation intragroupe et de flux internationaux.
2. L’audit interne régulier
La réalisation périodique d’audits internes permet de détecter en amont d’éventuelles anomalies susceptibles de susciter la suspicion de l’administration. Un contrôle spontané et préventif peut éviter des conséquences lourdes.
3. La préparation des dirigeants et salariés
Former les responsables et les collaborateurs aux réflexes à adopter en cas de visite est un gage de sécurité. Un protocole interne, précisant la conduite à tenir et les personnes à contacter immédiatement (notamment l’avocat fiscaliste du groupe), peut s’avérer décisif.
B. Pendant la perquisition : vigilance et sang-froid
1. L’attitude des dirigeants et salariés
Lors d’une perquisition, la coopération apparente est essentielle. Une opposition frontale pourrait être interprétée comme une obstruction et entraîner des sanctions. Cependant, cette coopération doit rester encadrée : il ne s’agit pas de livrer spontanément des informations qui ne seraient pas demandées.
2. Le rôle de l’avocat
La présence d’un avocat, si elle peut être organisée rapidement, est fondamentale. L’avocat veille à la régularité des opérations, à la proportionnalité des saisies et à la protection des documents couverts par le secret professionnel. Il conseille également le contribuable sur son attitude à adopter et sur les déclarations éventuelles.
3. La gestion des saisies électroniques
Les supports numériques constituent aujourd’hui une part importante des preuves recherchées. L’avocat doit être attentif à la manière dont les agents procèdent : périmètre des copies de données, protection des fichiers manifestement étrangers à l’objet de la visite, respect du secret professionnel. Tout dépassement pourra ensuite fonder une contestation.
C. Après la perquisition : analyse et riposte
1. Vérification de la régularité des opérations
Une fois la visite terminée, il convient d’analyser le procès-verbal dressé par l’huissier. Toute irrégularité doit être identifiée et consignée immédiatement : absence de notification régulière de l’ordonnance, dépassement du périmètre autorisé, saisie de documents non pertinents.
2. Exercice des voies de recours
L’appel devant le Premier président de la cour d’appel doit être envisagé dès que l’ordonnance ou les opérations présentent des fragilités. Cet appel peut conduire à l’annulation pure et simple de la perquisition et à la restitution des pièces saisies.
3. Élaboration d’une stratégie contentieuse
Si les documents saisis sont exploités fiscalement, l’entreprise doit se préparer à un contentieux de rectification. Une défense cohérente doit être articulée entre le volet fiscal (discussion des bases imposables, contestation des pénalités) et le volet pénal (préparation d’une stratégie de défense pénale). L’articulation de ces deux volets suppose une coordination étroite entre l’avocat fiscaliste et l’avocat pénaliste.
VI. Perspectives et évolutions récentes
La perquisition fiscale est un instrument ancien mais en constante évolution. L’encadrement de la procédure a été profondément marqué par la jurisprudence nationale et européenne, ainsi que par les réformes législatives successives. Les perspectives actuelles laissent entrevoir à la fois une consolidation des garanties pour le contribuable et un renforcement des moyens d’action de l’administration.
A. Jurisprudence récente
1. Les exigences de motivation renforcée
La Cour de cassation exige désormais une motivation substantielle des ordonnances autorisant la visite. Le juge doit préciser les éléments concrets sur lesquels reposent les présomptions de fraude et justifier la proportionnalité de la mesure. Cette exigence, directement inspirée de la CEDH, tend à limiter les ordonnances stéréotypées.
2. La nullité des opérations irrégulières
La sanction de l’irrégularité reste radicale. Toute visite ou saisie effectuée en dehors des conditions légales est nulle, et les documents ainsi recueillis sont écartés de la procédure. Cette nullité protège le contribuable et incite l’administration à une rigueur accrue.
3. La protection du secret professionnel
La jurisprudence récente accorde une attention particulière au respect du secret professionnel de l’avocat. La saisie de correspondances couvertes par ce secret est strictement encadrée. La Cour européenne et la Cour de cassation rappellent que la protection de la relation avocat-client constitue une garantie essentielle du procès équitable.
B. Évolutions législatives
1. Encadrement des saisies numériques
Le développement de la dématérialisation a conduit le législateur à renforcer les règles relatives à la saisie et à l’exploitation des données informatiques. Les scellés électroniques et la traçabilité des opérations deviennent la norme, afin de garantir l’intégrité et la loyauté de la preuve.
2. Articulation avec les enquêtes pénales
Les réformes récentes ont renforcé la coopération entre l’administration fiscale et le parquet. La procédure de « dénonciation obligatoire » au procureur, instaurée en 2018 pour les fraudes graves, accentue le lien entre le volet fiscal et le volet pénal. Les perquisitions fiscales sont ainsi de plus en plus intégrées à des stratégies d’enquêtes coordonnées.
3. Protection du secret de l’entreprise
Le législateur s’est également penché sur la question du secret des affaires. Les saisies ne doivent pas conduire à exposer des informations stratégiques sans rapport avec la fraude alléguée. Des limites sont posées pour préserver l’équilibre entre lutte contre la fraude et compétitivité économique.
C. Réflexions doctrinales
1. Vers une banalisation de la perquisition fiscale ?
Certains auteurs craignent une banalisation progressive de cette mesure exceptionnelle, au risque de la transformer en instrument courant de contrôle. L’augmentation du nombre d’ordonnances délivrées chaque année témoigne d’un recours plus fréquent, même si les juges rappellent régulièrement le caractère exceptionnel de la procédure.
2. Risques d’atteintes disproportionnées aux libertés individuelles
La perquisition fiscale met en tension deux exigences contradictoires : la protection des droits fondamentaux et l’efficacité de la lutte contre la fraude. La doctrine souligne que l’équilibre reste fragile et que la vigilance des juridictions supérieures, notamment la CEDH, demeure indispensable.
3. Comparaison avec d’autres États européens
Dans d’autres pays, les procédures équivalentes sont parfois plus strictement limitées. L’Allemagne ou l’Italie imposent un contrôle juridictionnel étroit et des conditions restrictives d’exploitation des pièces saisies. La France, sous l’influence européenne, tend à se rapprocher de ce modèle, mais conserve des spécificités liées à la structure de son droit fiscal.
Conclusion
La perquisition fiscale, prévue à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, illustre la tension permanente entre les impératifs de la lutte contre la fraude et la protection des libertés individuelles. Elle constitue une mesure d’exception, autorisée par le juge, qui permet à l’administration d’accéder au cœur de la sphère privée et professionnelle des contribuables pour y rechercher des preuves de dissimulation.
Son efficacité est indéniable : de nombreuses affaires de fraude complexe n’auraient pu être révélées sans cet outil intrusif. Mais son caractère attentatoire aux droits fondamentaux impose un encadrement rigoureux. La jurisprudence nationale et européenne a contribué à renforcer les garanties offertes au contribuable, en exigeant une motivation précise des ordonnances, en consacrant le recours effectif devant la cour d’appel et en sanctionnant sévèrement les irrégularités.
Pour les entreprises et dirigeants, l’enjeu est double. Il s’agit d’abord de prévenir le risque en adoptant une politique de conformité fiscale rigoureuse. Mais il s’agit aussi, en cas de visite, d’être prêts à réagir avec sang-froid, accompagnés d’un avocat compétent, afin de préserver leurs droits et d’anticiper les suites fiscales et pénales.
L’avenir de la perquisition fiscale dépendra de l’équilibre que trouveront législateur et juges entre deux exigences contradictoires : l’efficacité des investigations et la préservation des libertés. Ce qui est certain, c’est que cette procédure, longtemps marginale, est désormais appelée à jouer un rôle croissant dans la stratégie de lutte contre la fraude fiscale.




Commentaires